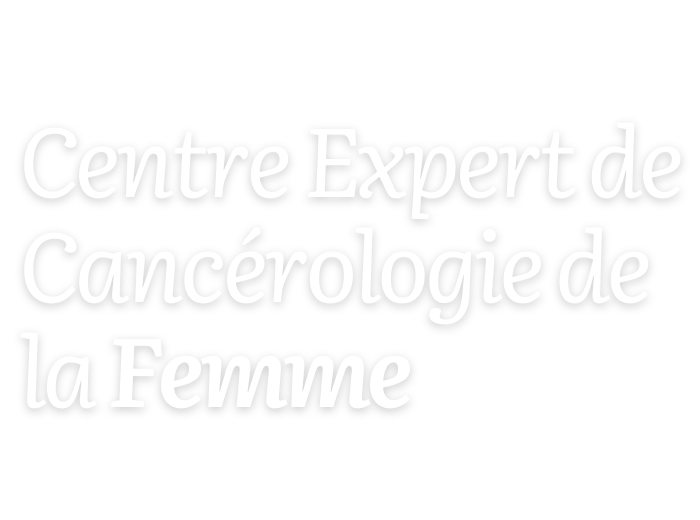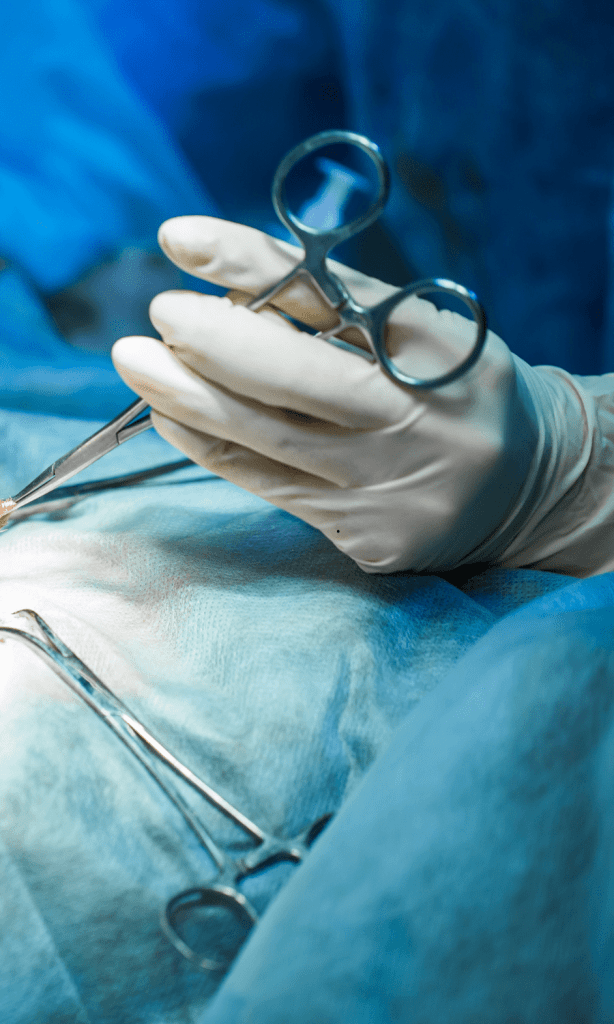Comprendre le cancer du col de l'utérus
Les lésions précancéreuses (CIN) Ce sont les stades précoces, avant l’apparition du cancer. On distingue trois grades :
- CIN1 (lésions de bas grade) : anomalies légères qui disparaissent souvent spontanément
- CIN2 (lésions de haut grade) : anomalies modérées nécessitant une surveillance ou un traitement
- CIN3 (lésions de haut grade) : anomalies sévères qui doivent être traitées car elles risquent d’évoluer vers un cancer
Le carcinome épidermoïde C’est la forme la plus fréquente (environ 80% des cas). Il se développe à partir des cellules qui tapissent la surface du col de l’utérus. Ce type de cancer se développe généralement lentement et peut être détecté précocement par le frottis.
L’adénocarcinome Plus rare (environ 20% des cas), il se développe dans les glandes du canal cervical. Cette localisation le rend parfois plus difficile à détecter lors du dépistage classique. Il touche souvent des femmes plus jeunes que le carcinome épidermoïde.